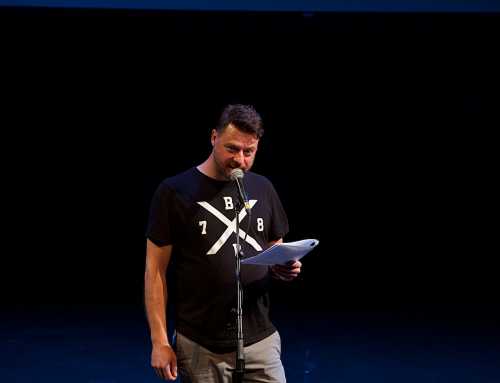Bienvenue chez nous au Manitoba. Le nom de notre province vient du mot algonquin manitou qui signifie en français « esprit » ou « entité spirituelle ». Ce nom fut suggéré à John A. Macdonald par le héros métis Louis Riel.
Lors de l’entrée du Manitoba dans la confédération en 1870, nous étions largement majoritaires. Aujourd’hui, bien que notre nombre soit en légère augmentation (de 47 100 en 2006 à 47 670 en 2011), notre pourcentage global est en perte de vitesse par rapport à l’anglais (de 4,2% en 2006 à 4,0% en 2011). Les trois quarts d’entre nous sont nés dans la province. L’immigration francophone à partir d’Europe et d’Afrique est en hausse. Selon le linguiste Jacques Leclerc : « Le français parlé par les Franco-Manitobains ressemble à celui des Québécois, mais il s’en différencie aussi par son caractère encore plus archaïsant (au point de vue phonétique, morphologique et lexical) et ses nombreux emprunts à l’anglais. De plus, les jeunes pratiquent systématiquement l’alternance codique (code-switching) avec des interférences entre les deux langues. Cependant, la situation semble plus complexe dans la mesure où il existe une diversité linguistique entre le français parlé dans la ville de Saint-Boniface (Winnipeg) et celui parlé dans les régions rurales (La Rouge, La Seine et La Montagne). »[2] En effet : « Le français de Saint-Boniface (Winnipeg) diffère des autres régions de la province parce que la concentration de francophones est plus élevée qu’ailleurs et que c’est dans ce quartier de la ville de Winnipeg qu’on y trouve toutes les activités culturelles et éducatives de cette communauté, notamment le Collège universitaire de Saint-Boniface. Le français parlé dans cette ville est donc relativement proche du français québécois commun standardisé. »[3] En 1971, un an après l’entrée du Manitoba dans la confédération canadienne, la population se chiffrait à 5700 Métis francophones, 4000 Métis anglophones et 1600 non-Métis d’origines écossaise et canadienne-française (originaires du Québec). La majorité francophone avait droit à une certaine protection linguistique.[4] Toujours selon Jacques Leclerc « parallèlement à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, l’article 23 de la Loi sur le Manitoba prévoyait que l’anglais et le français étaient permis à la Législature manitobaine et que les registres, procès-verbaux et lois devaient être rédigés et publiés dans les deux langues; les deux langues pouvaient également être utilisées dans les tribunaux manitobains de la province. L’article 22 de la Loi de 1870 sur le Manitoba garantissait un système d’écoles publiques confessionnelles subventionnées par la province. »[5] De plus, la Loi scolaire du Manitoba de 1871 prévoyait que le Board of Education doive fournir aux écoles de langue française tout le matériel didactique nécessaire (livres, cartes, etc.) en français. L’article 2 de la Loi relative aux municipalités (Act concerning Municipalities) de 1873 stipulait que toute demande visant la création d’une municipalité devait être publiée en français et en anglais dans la Gazette du Manitoba. Une autre loi de 1875 relative aux municipalités de comté du Manitoba (Act respecting County Municipalities) prévoyait la publication des règlements et avis municipaux dans les deux langues. Enfin, la Loi relative aux jurés et aux jurys (ou Act respecting Jurors and Juries) précisait que, lors d’un procès en français, le tribunal pouvait ordonner la constitution d’un jury composé d’un nombre égal de jurés francophones et anglophones. Ces mesures de protection ne devaient pas durer et les Franco-Manitobains commencèrent à subir l’assimilation. Tout bascula en 1890 avec la mise en vigueur de la Loi sur la langue officielle (Official Language Act) qui faisait de l’anglais la seule langue des registres, des procès-verbaux et des lois du gouvernement manitobain. L’anglais devenait ainsi la seule langue permise dans toutes les activités législatives et judiciaires. Puis ce fut le tour des écoles. La Législature adopta une loi prévoyant l’abolition des sections catholique et protestante afin de donner le contrôle de l’éducation à un « département d’Éducation ». Un second projet de loi fut présenté et adopté au sujet des écoles publiques, qui abolissait les écoles catholiques et prévoyait taxer les catholiques pour les écoles publiques. La Législature manitobaine enlevait à la minorité catholique les droits et privilèges dont elle avait joui antérieurement et jusqu’à cette époque. La situation commence à se renverser en 1976 « lorsque l’homme d’affaires Georges Forest [conteste] le fait qu’on lui [ait] servi une contravention unilingue anglaise sur le territoire de Winnipeg. Selon la requête, l’article de la Loi sur la langue officielle du Manitoba qui abolissait les droits du français dans la province (législature, lois et tribunaux) était illégal, parce que le gouvernement de l’époque ne pouvait abroger la Loi de 1870 sur le Manitoba, qui était une loi constitutionnelle. Cette loi prévoyait le bilinguisme législatif et judiciaire dans la province ».[6] La Cour suprême du Canada donne raison à monsieur Forest en 1979. En déclarant inconstitutionnelle la Loi sur la langue officielle de 1890 parce que la Loi de 1870 sur le Manitoba, une loi constitutionnelle, n’a jamais été abrogée et que, par conséquent, elle demeure toujours en vigueur. La Législature provinciale doit donc rester bilingue, conformément à l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. En 1985, une décision de la Cour suprême du Canada invalide toutes les lois adoptées depuis 1890 parce qu’elles n’avaient pas été adoptées à la fois en anglais et en français. De plus, selon le jugement, le gouvernement est tenu de fournir des services bilingues dans les tribunaux et à l’Assemblée législative. En 1989, la Cour d’appel du Manitoba décidait que les décrets rédigés en anglais seulement étaient invalides et inopérants. Ceux-ci demeuraient soumis au bilinguisme législatif, conformément à l’article 23 de la Loi sur le Manitoba. Enfin, en 1990, le Manitoba ratifiait un accord fédéral-provincial qui devait permettre à la province du Manitoba d’assurer, « là où le nombre le justifie », des services en français dans certains hôpitaux, centres d’accueil, bibliothèques et bureaux gouvernementaux. Le gouvernement manitobain a présenté à l’Assemblée législative sa politique touchant les services en français, mais celle-ci n’a jamais été consacrée par une loi. Évidemment, le gouvernement préfère se donner ainsi toutes les marges de manœuvre jugées nécessaires et pouvoir, s’il y a lieu, révoquer facilement les droits accordés. Ainsi, les services en langue française sont offerts dans des centres de services entièrement bilingues situés dans les régions désignées (il y en a trois). Ils sont également offerts, après autorisation ou détermination du ministre responsable des services en langue française, dans des centres de services partiellement bilingues où le nombre de postes et d’employés désignés bilingues est suffisant pour garantir la prestation efficace de tels services. Selon Jacques Leclerc, « les victoires des francophones sur le plan juridique n’ont pas fait nécessairement avancer leur cause. Elles ont provoqué à la fois un ressentiment du côté de la majorité anglaise et une réaction de crainte du côté de la minorité francophone. Il n’est pas dû au hasard que le gouvernement manitobain n’ait pas encore transposé dans une loi les droits de la minorité francophone. Dans cette province, les services en français sont protégés par une simple politique dont l’application dépend entièrement de la bonne volonté du gouvernement. Or, une simple politique n’aura jamais le poids d’une loi. Une loi, par exemple sur les services en français, permettrait de recourir aux tribunaux quand les efforts du gouvernement sont jugés insuffisants. Pour le moment, il n’existe aucun recours. De plus, les droits obtenus se réduisent à peu de choses : des écoles primaires, des procès partiellement en français, quelques formulaires bilingues et des services municipaux bilingues mais souvent boiteux dans la Ville de Winnipeg. »[7] En ce qui concerne la radio, la communauté francophone peut compter sur trois stations : une radio d’État (la Première Chaîne d’Ici Radio-Canada : CKSB) et deux radios privées (Envol 91 FM et CBAU, la radio étudiante du Collège universitaire de Saint-Boniface). Toutefois, dans ce milieu minoritaire, une station privée comme Envol doit composer avec des sources de financement limitées. C’est aussi la seule radio communautaire du Manitoba et la seule radio communautaire francophone. Pour la télévision, les francophones peuvent syntoniser CBWFT-TV (Ici Radio-Canada au Manitoba). Grâce à la câblodistribution, les francophones ont accès à RDI (Réseau de l’information d’Ici Radio-Canada), à TVA (réseau privé en provenance du Québec et présent dans la plupart des provinces), à TFO-Ontario (télévision francophone de l’Ontario) et à TV5 (télévision de la Francophonie internationale). Nous avons également une association : l’Association culturelle franco-manitobaine, l’ACFM.[8] Sa mission est de contribuer « au développement de la culture et des arts francophones en facilitant la mise en place d’une programmation et des services d’appui aux comités culturels membres. » Patrie de l’immense écrivaine Gabrielle Roy et du chanteur-compositeur Daniel Lavoie, le Manitoba continue de produire des écrivains, des compositeurs ainsi que des acteurs et des actrices. Selon Rosemarin Heidenreich : « Néanmoins, les problèmes de réception et d’institutionnalisation dans notre culture très enrégimentée ne sont pas résolus pour les écrivains franco-manitobains. À l’exception de deux librairies et de deux maisons d’édition francophones à Saint-Boniface, la communauté francophone du Manitoba ne possède pratiquement aucune infrastructure littéraire. Bien que le nombre de personnes nées au Manitoba qui reconnaissent le français comme langue maternelle semble diminuer lentement, la population francophone totale semble augmenter, en raison de l’immigration provenant des pays francophones et du Québec. La population francophile (les personnes intéressées à la langue et à la culture françaises et qui peuvent lire et écrire le français) a connu une augmentation spectaculaire en raison de l’importance des programmes d’immersion française et d’autres facteurs. »[9] ➤ Danielle E. Cyr, spécialiste en linguistique • © photo en-tête : Jean-Yves Fréchette[1] Source : www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-314-x/2011003/tbl/tbl3_1-6-fra.cfm
[2] Source : axl.cefan.ulaval.ca/amnord/manitoba.htm
[3] Id.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Voir : acfm.ca/repertoire-culturel/artistes/?section=4&view=2
[9] Rosmarin Heidenreich « Production et réception des littératures minoritaires : le cas des auteurs franco- manitobains. » Francophonies d’Amérique 1 (1991) : 87–97. DOI : 10.7202/1004265ar